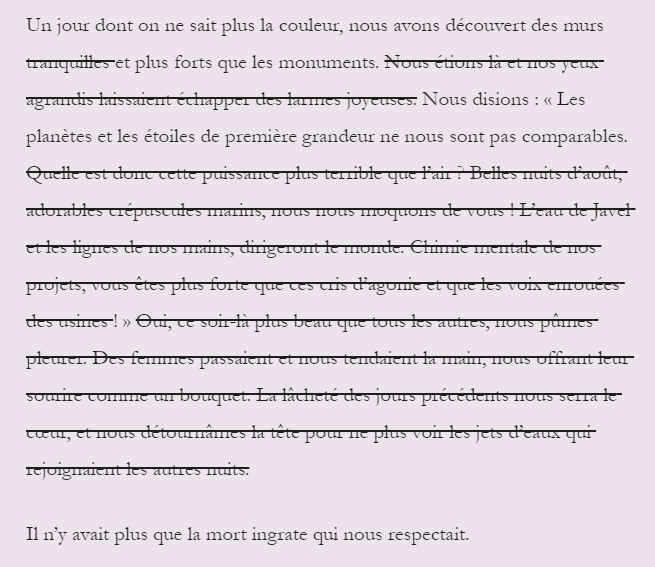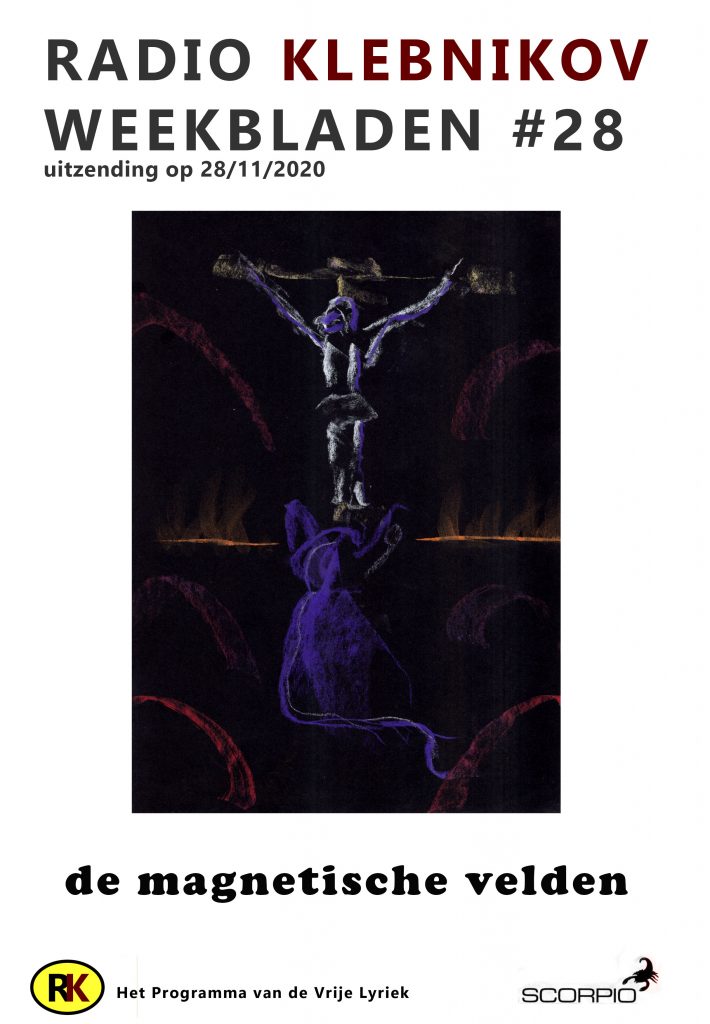
lecture farine de Breton / Soupault – Les Champs magnetiques ISBN 978-2-07-031877-3, p. 27-33
Prisonniers des gouttes d’eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Nous courons dans les villes sans bruits et les affiches enchantées ne nous touchent plus. À quoi bon ces grands enthousiasmes fragiles, ces sauts de joie desséchés ? Nous ne savons plus rien que les astres morts ; nous regardons les visages ; et nous soupirons de plaisir. Notre bouche est plus sèche que les plages perdues ; nos yeux tournent sans but, sans espoir. Il n’y a plus que ces cafés où nous nous réunissons pour boire ces boissons fraîches, ces alcools délayés et les tables sont plus poisseuses que ces trottoirs où sont tombées nos ombres mortes de la veille.
Quelquefois, le vent nous entoure de ses grandes mains froides et nous attache aux arbres découpés par le soleil. Tous, nous rions, nous chantons, mais personne ne sent plus son cœur battre. La fièvre nous abandonne.
Les gares merveilleuses ne nous abritent plus jamais : les longs couloirs nous effraient. Il faut donc étouffer encore pour vivre ces minutes plates, ces siècles en lambeaux. Nous aimions autrefois les soleils de fin d’année, les plaines étroites où nos regards coulaient comme ces fleuves impétueux de notre enfance. Il n’y a plus que des reflets dans ces bois repeuplés d’animaux absurdes, de plantes connues.
Les villes que nous ne voulons plus aimer sont mortes. Regardez autour de vous : il n’y a plus que le ciel et ces grands terrains vagues que nous finirons bien par détester. Nous touchons du doigt ces étoiles tendres qui peuplaient nos rêves. Là-bas, on nous a dit qu’il y avait des vallées prodigieuses : chevauchées perdues pour toujours dans ce Far West aussi ennuyeux qu’un musée.
Lorsque les grands oiseaux prennent leur vol, ils partent sans un cri et le ciel strié ne résonne plus de leur appel. Ils passent au-dessus des lacs, des marais fertiles ; leurs ailes écartent les nuages trop langoureux. Il ne nous est même plus permis de nous asseoir : immédiatement, des rires s’élèvent et il nous faut crier bien haut tous nos péchés.
Un jour dont on ne sait plus la couleur, nous avons découvert des murs tranquilles et plus forts que les monuments. Nous étions là et nos yeux agrandis laissaient échapper des larmes joyeuses. Nous disions : « Les planètes et les étoiles de première grandeur ne nous sont pas comparables. Quelle est donc cette puissance plus terrible que l’air ? Belles nuits d’août, adorables crépuscules marins, nous nous moquons de vous ! L’eau de Javel et les lignes de nos mains, dirigeront le monde. Chimie mentale de nos projets, vous êtes plus forte que ces cris d’agonie et que les voix enrouées des usines ! » Oui, ce soir-là plus beau que tous les autres, nous pûmes pleurer. Des femmes passaient et nous tendaient la main, nous offrant leur sourire comme un bouquet. La lâcheté des jours précédents nous serra le cœur, et nous détournâmes la tête pour ne plus voir les jets d’eaux qui rejoignaient les autres nuits.
Il n’y avait plus que la mort ingrate qui nous respectait.
Chaque chose est à sa place, et personne ne peut plus parler : chaque sens se paralysait et des aveugles étaient plus dignes que nous.
On nous a fait visiter des manufactures de rêves à bon marché et les magasins remplis de drames obscurs. C’était un cinéma magnifique où les rôles étaient tenus par d’anciens amis. Nous les perdions de vue et nous allions les retrouver toujours à cette même place. Ils nous donnaient des friandises pourries et nous leur racontions nos bonheurs ébauchés. Leurs yeux fixés sur nous, ils parlaient : peut-on vraiment se souvenir de ces paroles ignobles, de leurs chants endormis ?
Nous leur avons donné notre cœur qui n’était qu’une chanson pâle.
Ce soir, nous sommes deux devant ce fleuve qui déborde de notre désespoir. Nous ne pouvons même plus penser. Les paroles s’échappent de nos bouches tordues, et, lorsque nous rions, les passants se retournent, effrayés, et rentrent chez eux précipitamment.
On ne sait pas nous mépriser.
Nous pensons aux lueurs des bars, aux bals grotesques dans ces maisons en ruines où nous laissions le jour. Mais rien n’est plus désolant que cette lumière qui coule doucement sur les toits à cinq heures du matin. Les rues s’écartent silencieusement et les boulevards s’animent : un promeneur attardé sourit près de nous. Il n’a pas vu nos yeux pleins de vertiges et il passe doucement. Ce sont les bruits des voitures de laitiers qui font s’envoler notre torpeur et les oiseaux montent au ciel chercher une divine nourriture.
Aujourd’hui encore (mais quand donc finira cette vie limitée) nous irons retrouver les amis, et nous boirons les mêmes vins. On nous verra encore aux terrasses des cafés.
Il est loin, celui qui sait nous rendre cette gaîté bondissante. Il laisse s’écouler les jours poudreux et il n’écoute plus ce que nous disons. « Est-ce que vous avez oublié nos voix enveloppées d’affections et nos gestes merveilleux ? Les animaux des pays libres et des mers délaissées ne vous tourmentent-ils plus ? je vois encore ces luttes et ces outrages rouges qui nous étranglaient. Mon cher ami, pourquoi ne voulez-vous plus rien dire de vos souvenirs étanches ? » L’air dont hier encore nous gonflions nos poumons devient irrespirable. Il n’y a plus qu’à regarder droit devant soi, ou à fermer les yeux : si nous tournions la tête, le vertige ramperait jusqu’à nous.
Itinéraires interrompus et tous les voyages terminés, est-ce que vraiment nous pouvons les avouer ? Les paysages abondants nous ont laissé un goût amer sur les lèvres. Notre prison est construite en livres aimés, mais nous ne pouvons plus nous évader, à cause de toutes ces odeurs passionnées qui nous endorment.
Nos habitudes, maîtresses délirantes, nous appellent : ce sont des hennissements saccadés, des silences plus lourds encore. Ce sont ces affiches qui nous insultent, nous les avons tant aimées. Couleur des jours, nuits perpétuelles, est-ce que vous aussi, vous allez nous abandonner ?
L’immense sourire de toute la terre ne nous a pas suffi : il nous faut de plus grands déserts, ces villes sans faubourgs et ces mers mortes.
Nous touchons à la fin du carême. Notre squelette transparaît comme un arbre à travers les aurores successives de la chair où les désirs d’enfant dorment à poings fermés. La faiblesse est extrême. Hier encore, nous glissions sur des écorces merveilleuses en passant devant les merceries.
Chaque chose est à sa place, et personne ne peut plus parler : chaque sens se paralysait et des aveugles étaient plus dignes que nous.
On nous a fait visiter des manufactures de rêves à bon marché et les magasins remplis de drames obscurs. C’était un cinéma magnifique où les rôles étaient tenus par d’anciens amis. Nous les perdions de vue et nous allions les retrouver toujours à cette même place. Ils nous donnaient des friandises pourries et nous leur racontions nos bonheurs ébauchés. Leurs yeux fixés sur nous, ils parlaient : peut-on vraiment se souvenir de ces paroles ignobles, de leurs chants endormis ?
Nous leur avons donné notre cœur qui n’était qu’une chanson pâle.
Ce soir, nous sommes deux devant ce fleuve qui déborde de notre désespoir. Nous ne pouvons même plus penser. Les paroles s’échappent de nos bouches tordues, et, lorsque nous rions, les passants se retournent, effrayés, et rentrent chez eux précipitamment.
On ne sait pas nous mépriser.
Nous pensons aux lueurs des bars, aux bals grotesques dans ces maisons en ruines où nous laissions le jour. Mais rien n’est plus désolant que cette lumière qui coule doucement sur les toits à cinq heures du matin. Les rues s’écartent silencieusement et les boulevards s’animent : un promeneur attardé sourit près de nous. Il n’a pas vu nos yeux pleins de vertiges et il passe doucement. Ce sont les bruits des voitures de laitiers qui font s’envoler notre torpeur et les oiseaux montent au ciel chercher une divine nourriture.
Aujourd’hui encore (mais quand donc finira cette vie limitée) nous irons retrouver les amis, et nous boirons les mêmes vins. On nous verra encore aux terrasses des cafés.
Il est loin, celui qui sait nous rendre cette gaîté bondissante. Il laisse s’écouler les jours poudreux et il n’écoute plus ce que nous disons. « Est-ce que vous avez oublié nos voix enveloppées d’affections et nos gestes merveilleux ? Les animaux des pays libres et des mers délaissées ne vous tourmentent-ils plus ? je vois encore ces luttes et ces outrages rouges qui nous étranglaient. Mon cher ami, pourquoi ne voulez-vous plus rien dire de vos souvenirs étanches ? » L’air dont hier encore nous gonflions nos poumons devient irrespirable. Il n’y a plus qu’à regarder droit devant soi, ou à fermer les yeux : si nous tournions la tête, le vertige ramperait jusqu’à nous.
Itinéraires interrompus et tous les voyages terminés, est-ce que vraiment nous pouvons les avouer ? Les paysages abondants nous ont laissé un goût amer sur les lèvres. Notre prison est construite en livres aimés, mais nous ne pouvons plus nous évader, à cause de toutes ces odeurs passionnées qui nous endorment.
Nos habitudes, maîtresses délirantes, nous appellent : ce sont des hennissements saccadés, des silences plus lourds encore. Ce sont ces affiches qui nous insultent, nous les avons tant aimées. Couleur des jours, nuits perpétuelles, est-ce que vous aussi, vous allez nous abandonner ?
L’immense sourire de toute la terre ne nous a pas suffi : il nous faut de plus grands déserts, ces villes sans faubourgs et ces mers mortes.
Nous touchons à la fin du carême. Notre squelette transparaît comme un arbre à travers les aurores successives de la chair où les désirs d’enfant dorment à poings fermés. La faiblesse est extrême. Hier encore, nous glissions sur des écorces merveilleuses en passant devant les merceries. Ce doit être à présent ce qu’il est convenu d’appeler l’âge d’homme : en regardant de côté, n’a-t-on pas vue sur une place triste éclairée avant qu’il fasse nuit ? Les rendez-vous d’adieu qui s’y donnent traquent pour la dernière fois les animaux dont le cœur est percé d’une flèche.
Suspendues à nos bouches, les jolies expressions trouvées dans les lettres n’ont visiblement rien à craindre des diabolos de nos cœurs, qui nous reviennent de si haut que leurs coups sont incomptables.
C’est à la lueur d’un fil de platine que l’on traverse cette gorge bleuâtre au fond de laquelle séjournent des cadavres d’arbres rompus et d’où monte l’odeur de créosote qu’on dit bonne pour la santé.
Ceux qui ne se veulent pas même aventuriers vivent aussi au grand air ; ils ne se laissent pas emporter par leurs imaginations fiévreuses et, du train où ils vont, tout bas : rien ne s’oppose à ce qu’ils tirent du mâchefer les verroteries qui apprivoisent certaines peuplades. Ils prennent lentement conscience de leur force qui est de savoir rester immobiles au milieu des hommes qui ôtent leur chapeau et des femmes qui vous sourient à travers un papillon du genre sphynx. Ils enveloppent de papier d’argent leurs paroles glaciales, disant : « Que les grands oiseaux nous jettent la pierre, ils ne couveront rien dans nos profondeurs » et ne changeraient pas de place avec les gravures de modes. Je ris, tu ris, il rit, nous rions aux larmes en élevant le ver que les ouvriers veulent tuer. On a le calembour aux lèvres et des chansons étroites.
Un jour, on verra deux grandes ailes obscurcir le ciel et il suffira de se laisser étouffer dans l’odeur musquée de partout. Comme nous en avons assez de ce son de cloches et de faire peur à nous-mêmes ! Étoiles véritables de nos yeux, quel est votre temps de révolution autour de la tête ? Vous ne vous laissez plus glisser dans les cirques et voilà donc que le soleil froisse avec dédain les neiges éternelles ! Les deux ou trois invités retirent leur cache-col. Quand les liqueurs pailletées ne leur feront plus une assez belle nuit dans la gorge, ils allumeront le réchaud à gaz. Ne nous parlez pas de consentement universel ; l’heure n’est plus aux raisonnements d’eau de Botot et nous avons fini par voiler notre roue dentée qui calculait si bien. Nous regrettons à peine de ne pouvoir assister à la réouverture du magasin céleste dont les vitres sont passées de si bonne heure au blanc d’Espagne.
Ce qui nous sépare de la vie est bien autre chose que cette petite flamme courant sur l’amiante comme une plante sablonneuse. Nous ne pensons pas non plus à la chanson envolée des feuilles d’or d’électroscope qu’on trouve dans certains chapeaux haut de forme, bien que nous portions en société un de ceux-là.
La fenêtre creusée dans notre chair s’ouvre sur notre cœur. On y voit un immense lac où viennent se poser à midi des libellules mordorées et odorantes comme des pivoines. Quel est ce grand arbre où les animaux vont se regarder ? il y a des siècles que nous lui versons à boire. Son gosier est plus sec que la paille et la cendre y a des dépôts immenses. On rit aussi, mais il ne faut pas regarder longtemps sans longue vue. Tout le monde peut y passer dans ce couloir sanglant où sont accrochés nos péchés, tableaux délicieux, où le gris domine cependant.
Il n’y a plus qu’à ouvrir nos mains et notre poitrine pour être nus comme cette journée ensoleillée. « Tu sais que ce soir il y a un crime vert à commettre. Comme tu ne sais rien, mon pauvre ami. Ouvre cette porte toute grande, et dis-toi qu’il fait complètement nuit, que le jour est mort pour la dernière fois. »
L’histoire rentre dans le manuel argenté avec des piqûres et les plus brillants acteurs préparent leur entrée. Ce sont des plantes de toute beauté plutôt mâles que femelles et souvent les deux à la fois. Elles ont tendance à s’enrouler bien des fois avant de s’éteindre fougères. Les plus charmantes se donnent la peine de nous calmer avec des mains de sucre et le printemps arrive. Nous n’espérons pas les retirer des couches souterraines avec les différentes espèces de poissons. Ce plat ferait bon effet sur toutes les tables. C’est dommage que nous n’ayons plus faim.
Voorbereiding voor opname
in de RADIO KLEBNIKOV WEEKBLADEN #28